POÊTES(SES) HUMANISTES
Cette bourse, ainsi que le revenu de ses articles lui permettent de prendre gîte en 1926 à l’hôtel Richelieu ; il fréquente les expositions, les concerts et les cafés ; il rencontre Artaud, Tzara, Desnos, Marcel Aymé, Picasso, Cocteau…Mais il entre également en relation avec Juan Larrea, qui deviendra son ami. Larrea est un poète d’origine basque, qui mourra en 1980, à 85 ans, en Argentine. Il a participé au mouvement « créationniste », s’est ensuite orienté vers l’ultraïsme, puis vers le surréalisme. Une grande partie de son œuvre est écrite en français ; ayant été diffusée de façon très restreinte, elle est très peu connue. Son credo personnel l’éloigne de toute contrainte, de toute norme artistique, de toute hypocrisie. « Aujourd’hui, en 1926, dit Larrea, l’art est un problème de générosité. […] Intelligence et sensibilité sont ennemies, non dans le temps ni dans l’espace, mais à l’intérieur de chaque être humain, là où elles existent uniquement.
« Je n’éprouve pas cette douleur en tant que César Vallejo. Je ne souffre pas à présent en tant qu’artiste, en tant qu’homme ni même comme simple être vivant. Je n’éprouve pas cette douleur en tant que catholique, mahométan ou athée. Aujourd’hui je souffre simplement. Si je ne me nommais pas César Vallejo, je sentirais aussi cette douleur. Si je n’étais pas artiste, je l’éprouverais aussi. Si je n’étais ni catholique, ni athée, ni mahométan, je l’éprouverais aussi. Aujourd’hui je souffre de plus bas. Aujourd’hui je souffre simplement. » (« Je vais parler de l’espérance »
CESAR VALLEJO
C’est l’être humain qui observe, qui développe, qui imagine, interprète et partage le fond de ce qu’il peut y exister de commun d’avec sa position, son statut, son discernement envers les possibilités, potentialités et facultés d’analyse qu’il réussit à examiner dans le développement d’une union de sens, d’accords et de liens à ce qu’elle puisse y être de l’entendement d’une désunion du reste de son existence particulière en suite d’une démonstration logique actée sur l’obligeance à n’y point s’y méprendre des impressions vagues quant à ses intérêts faussement intéressés par un sujet dont l’objet commun n’y trouverait d’une provision de restriction affichée par une direction en attentions reléguées loin de la bienséance entre attachement présomptueux et liberté circonstancielle qui n’aurait de bienveillance que celle d’une tromperie envers une vérité dénuée de tout principe refusant de l’affirmer sans mesure d’une quelconque recherche de preuves ; dont nous ne sommes rigoureusement sûrs de rien quant au désir à ne plus vouloir s’attacher inopinément à un sentiment sans vraisemblances d’une connectivité en conduite du respect de la différence de modalités envers ses congénères de même aptitudes à ne plus vouloir de l’imposture que celle de s’éloigner du soupçon d’imbécilité peu embarrassé par des codes admis par un conformisme placé sous le signe d’une conspiration obstinée à suivre les chemins déjà battus par le prix des inactions inaliénables d’avec les sentiers de traverses comme si l’homme sans chaînes apparentes devraient se satisfaire tant de la suspicion démagogique en liberté d’expressions que de l’amertume actée par une justice de persécution pour qui n’aurait pas compris les compromissions d’entre les hommes, comme de celles entre femmes et hommes, et réciproquement…
‘’C’EST TROP LONG’’
De quoi parle-t-on ?
D’un texte qui serait composé d’un grand nombre de lignes, mots et paragraphes ?
D’un alanguissement envers ces ‘’choses’’ de la vie ?
Cette pesanteur de longueur ou langueur textuelle pesante ne saurait être qu’une appréciation individuelle formulée par un choix non moins personnel mais qui ne peut en aucune mesure être formulation intensive envers l’autre !
‘’JE SUIS FATIGUE(E)’’
C’est une sensation qui se veut, en majorité des cas, certainement réelle.
Est-ce un fatigue physique OU/ET psychologique ?
‘’JE N’AI PLUS LE TEMPS’’
Cela est peut-être vrai…
Mais s’agit-il d’une vérité individuelle, collective et, passagère ou est-ce une excuse réductrice et lacunaire permettant d’éviter la substance des idées envers ces ‘’choses extérieures’’, à soi, pouvant perturber les consciences bien ‘’agencées’’... ; comme il pourrait en être des esprits simplistes voire ignorant…
On ne devient pas vieux pour avoir vécu un certain nombre d’années. On devient vieux parce que l’on a déserté son idéal. Vous êtes aussi jeune que votre enthousiasme, vos désirs, vos souhaits, votre bienveillance, vos attentions et votre belle curiosité, aussi vieux que votre air désabusé, votre morne attitude, vos certitudes conformistes, votre malveillance intergénérationnelle. Nous sommes aussi jeunes que notre confiance en nous et aussi vieux que notre abattement, nos peurs, notre refus d’analyse et notre acceptation d’ostracisme.
Michel Asti
LES AVENTURIERS DE L'ART MODERNE
https://www.youtube.com/watch?v=q7zMYBHK_s4 - Episode 1/6
https://www.youtube.com/watch?v=8vs4OSu22GM - Episode 2/6
https://www.youtube.com/watch?v=5qJ1vS3BbXY - Episode 3/6
https://www.youtube.com/watch?v=qtckJFF4XSs - Episode 4/6
https://www.youtube.com/watch?v=Oyq6sOdISeE - Episode 5/6
https://www.youtube.com/watch?v=dlupk7D3c0w - Episode 6/6
« Et vous croyez, monsieur Vallejo, qu’entasser des imbécillités l’une sur l’autre, c’est faire de la poésie ? » Ainsi s’exprima monsieur Clemente Palma, pontife des lettres péruviennes, au temps où César Vallejo était un obscur poète de province au large front pensif, et le sourcil froncé – on connaît la célèbre photographie, prise plus tard dans sa vie, où il regarde en effet le lointain, le menton fermement appuyé sur la main droite, plis obliques descendant de part et d’autre du nez, bouche close, et la seconde main tenant la canne. Pause avant l’affrontement, à peine pose, bien sûr, mais détermination, défi au réel, plutôt. Uniquement cela, – tenir, tenir. Une élégance supérieure, dans toute la personne de Vallejo… Une distinction faite de distance au plus près, de connivence avec ce qui vient et reste du plus loin, d’adéquation avec la pierre sèche où se nourrit toute tendresse, de réserve et de crânerie sans autre orgueil que celui qui n’ignore rien de ce qu’il faut attendre de la vie. Un être courtois, avec la mort qui sait son heure, le malheur qui étonne, ou l’amour qui renverse les certitudes, et fait plier les corps… Un homme prêt en permanence à affronter.
Le critique visait l’ensemble de Trilce, mais cela aurait pu être déjà telle strophe du Poema a mi amada : Amada, esta noche tú te has sacrificado sobre los dos maderos curvados de mi beso ; y tu pena me ha dicho que Jesús ha llorado, y que hay un viernesanto más dulce que ese beso.
« Aimée, cette nuit tu t’es crucifiée sur les deux madriers courbés de mon baiser ; et ta peine m’a dit que Jésus a pleuré, et qu’il est un vendredi saint plus doux que ce baiser. »
Seul monsieur Palma, obscur et antique cardinal des lettres péruviennes, pouvait déceler dans une pareille strophe un soupçon d’imbécillité. On y perçoit surtout et seulement l’énergie d’une langue peu embarrassée de respecter les codes admis. Vallejo n’a jamais eu la fibre conformiste, c’est évident. Toute son existence le montre ; toute son oeuvre est placée sous le signe, précisément, de l’écart. Il fut de ceux qui créent leurs propres normes. Défi engagé très tôt, par conséquent, puis tenu sans faillir, jusqu’au bout. Suivre les sentiers battus ? Une impossibilité. Battre fermement, avec l’obstination d’un qui sait le prix des accomplissements véridiques, le sol de ses propres chemins. Les aléas ? Intégrés. Démarche souveraine. Les œuvres en sont les traces : le passage de cet homme est le moins vain de tous.
Né le 16 mars 1892 à Santiago de Chuco, petit village isolé du nord des Andes du Pérou, César Abraham Vallejo Mendoza est issu d’une lignée originale : ses deux grands-mères étaient des indiennes Chimu et l’un comme l’autre de ses grands-pères, des prêtres catholiques d’origine espagnole. Le plus jeune d’une famille de onze enfants, il fut élevé dans une maisonnée saturée de dévotion. La misère fut sa muse première, mais il connut la chaleur d’un foyer aimant. Il lui fallut interrompre plusieurs fois ses études entre 1908 et 1913, et particulièrement ses études universitaires, à Trujillo, à partir de 1910, par manque de moyens financiers. Il dut donner des cours particuliers, et, également, travailler, à la comptabilité, dans une vaste exploitation sucrière : les ouvriers, en masse, du matin à l’aube à la tombée de la nuit, gagnaient là quelques centimes à la journée, et une poignée de riz. On peut comprendre que le sens de la dénomination des choses réelles aient connu dans sa poésie une certaine distorsion, que le censeur sourcilleux de l’imbécillité aura eu du mal à saisir. On comprendra aussi aisément le sens des engagements politiques et moraux du poète.
Il fréquente alors de nombreux artistes et intellectuels, dont le groupe Norte, sous la direction d’Antenor Orrego. L’époque est celle de mouvements sociaux, de changements politiques (l’armée pousse à la mise en cause de l’oligarchie qui dirige le pays) et intellectuels (le marxisme fait son apparition, ainsi que la psychanalyse) ; Vallejo publie ses premiers poèmes.
1913 : revenu à l’Université, il fait son Droit, tout en s’intéressant en parallèle à la littérature, lisant avec passion autant ce qui pouvait concerner l’évolution et le déterminisme scientifique que la mythologie. L’étude du Droit se poursuit jusqu’en 1917, après une maîtrise en littérature espagnole obtenue en 1915. Une aventure amoureuse assez tourmentée le contraint à partir pour Lima. Devenu enseignant dans une école de prestige, il fréquente cependant la bohème locale durant ses nuits, et fait l’expérience de l’opium. Il rencontre les figures de la littérature locale de l’époque, et surtout Manuel Gonzalez Prada, un des leaders de la gauche péruvienne, et Abraham Valdelomar ; grâce à ce dernier, il intègre le groupe Colonida, et se met au courant des nouveautés européennes. La mort de Prada l’affecte profondément. Le poème « Los dados eternos », « Les dés éternels », est dédié à sa mémoire :
Dios mío, estoy llorando el ser que vivo; me pesa haber tomádote tu pan ; pero este pobre barro pensativo no es costra fermentada en tu costado : tú no tienes Marías que se van !!
« Mon Dieu, je pleure sur l’être que je vis ; je regrette d’avoir pris ton pain ; mais la pauvre boue pensive que je suis n’est pas croûte fermentée dans ton flanc : toi tu n’as pas de Maries qui s’en vont ! »
[…]
Dios mío, y esta noche sorda, oscura, ya no podrás jugar, porque la Tierra es un dado roído y ya redondo a fuerza de rodar a la aventura, que no puede parar sino en un hueco, en el hueco de immensa sepultura.
« Mon Dieu, en cette nuit sourde, obscure, tu ne pourras plus jouer, car la Terre est un dé rongé et désormais rond à force de rouler à l’aventure, qui ne peut s’arrêter que dans un trou, le trou d’une immense sépulture. »
Le marxisme devenant de plus en plus la source où il s’abreuve, il s’éloigne de ce cercle « élitiste », dans lequel il se sent enfermé. La disparition de son maître et ami ne fait que le plonger dans ce constant désespoir, cette crise intime permanente qui constituera sa marque.
Quand il publie à la mi-juillet 1919 Los heraldos negros, le recueil (jamais republié du vivant le l’auteur) est accueilli avec faveur. Mais Vallejo oriente sa production dans une direction nouvelle : il a déjà écrit plusieurs des poèmes qui viendront composer Trilce. Il perd son second poste d’enseignant à la suite d’une affaire sentimentale complexe, dont certains de ces poèmes se feront l’écho : il a rompu avec son amie Otilia Villanueva en mai ou juillet, selon les conjectures, de cette année 1919, qui apparaît comme un tournant dans son existence. Il doit faire le deuil de sa mère, disparue en août 1918. Et les années suivantes sont marquées par cette absence ainsi que celle d’Otilia, augmentée de celles de deux autres femmes, Zoila Rosa Cuadra, connue sous le nom de Mirtho, et une autre Otilia qui vivait à Santiago de Chuco. On perçoit dans le poème des Hérauts noirs déjà cité (« Los dados eternos ») une allusion à une autre femme encore, María Rosa Sandóval, morte également. Trilce, tout du long, sera sous le signe de cette présence inexorable de la mort dans le vide du passé révolu, celui des jeux avec les frères, des rites familiaux, de la communion autour des repas dans le foyer perdu. Les amours perdues rejoignent dans l’absence la mère morte. Dans les évocations érotiques, le fait même que deux personnes aimées aient porté le même prénom pousse à l’identification, sans qu’il faille y voir un goût pour la simple anecdote. La relation entre la mort de la mère et l’absence des amantes est déjà sensible dans « Nervazón de angustia », « Nervaison d’angoisse » ; on la retrouve dans le poème XLVI (un sonnet) de Trilce :
La tarde cocinera se detiene ante la mesa donde tú comiste ; y muerta de hambre tu memoria viene sin probar ni agua, de lo puro triste.
« L’après-midi cuisinière s’attarde devant la table où tu as déjeuné ; et morte de faim vient ta mémoire sans même prendre d’eau, de pure tristesse. »
Cette inspiration érotique et amoureuse ne refera que de brèves incursions dans la poésie postérieure de Vallejo. C’est l’épreuve de la prison qui a porté son empreinte sur cette période. Vallejo fut absurdement mêlé à des troubles qui eurent lieu à Santiago de Chuco le 1er août 1920. Après avoir passé deux mois de vacances dans son village natal, il était revenu à Trujillo au début juillet 1920 ; puis, il avait repris le chemin de Santiago, pour assister à la fête du saint patron. La situation politique était alors « hautement inflammable », selon un biographe. Lors d’une querelle, un assistant du sous-préfet avait été tué, et un incendie avait réduit en cendres le grand magasin local. Un magistrat enquêteur, envoyé sur les lieux depuis Trujillo fit retenir pour interrogatoire une douzaine de personnes, dont Vallejo et deux de ses frères. Il fut accusé d’être l’« instigateur intellectuel » des événements. Avant même toute instruction, le journal La Industria de Trujillo avait formulé une dénonciation à son endroit. Ces accusations furent plus tard réfutées par lui. Mais fin août, les charges furent retenues contre lui, et il se cacha quelque temps chez un ami, dans la campagne proche de Trujillo, jusqu’à son arrestation le 7 novembre. Malgré le soutien et les protestations de ses amis intellectuels et des journaux, il fut emprisonné pendant 112 jours, jusqu’au 26 février de l’année suivante. Libéré sur parole, il rejoignit Lima, dans l’amertume de l’injustice subie. Trilce, écrit en grande partie pendant qu’il se cachait avant son arrestation, est publié en 1922 ; le recueil semble venu de nulle part : c’est le poème répété (pas de titres, mais des en-têtes numérotés, uniquement) de la vie clandestine, de la persécution. L’angoisse de l’homme traqué, l’oppression des quatre murs de la cellule alternent avec les souvenirs, les évocations de la vie libre.
Le 12 février, de sa geôle, il écrit à son ami Oscar Imaña :
« Dans ma cellule je lis de temps en temps ; il m’arrive à certains moments de broyer du noir et de ne plus me sentir de rage, non tant à cause du déshonneur qui m’atteint que de la privation matérielle, la totale privation matérielle de ma liberté animale. C’est quelque chose d’horrible, Oscar. J’écris aussi par moments, et si un souffle d’air agréable me parvient jusqu’à l’âme, c’est la lumière du souvenir. Ah, la mémoire, en prison ! Elle revient, elle part du coeur, elle apporte l’huile à la mélancolie à la machine qui se déglingue… » De fait, outre les poèmes de Trilce directement inspirés par cette douloureuse expérience, Vallejo rédige là des récits brefs, qui porteront le titre d’Escalas, à leur publication en 1923. Tensions, ruptures, silences : la rédaction de ces proses partage cela avec Trilce. De même, liaison des poèmes LXIV, LXX et LXXV de Trilce avec les poèmes de Paris. La filiation, du moins la continuité, la connexion d’une œuvre à l’autre est évidente.
Durant l’année 1922, à Lima, Vallejo continua à enseigner, mais en 1923, son poste fut supprimé. Dans la crainte d’une nouvelle incarcération, le cholo (le terme désigne en Amérique latine un homme d’ascendance à la fois amérindienne et espagnole) accepte alors la proposition de son ami Julio Gálvez de se rendre à Paris, et quitte le Pérou en juin. À Paris, la situation des deux amis n’est pas brillante, et la faim menace. Ce n’est qu’en 1925 que Vallejo finit par trouver un emploi stable, dans une agence de presse récemment ouverte ; il reçoit également une bourse mensuelle du ministère espagnol afin de poursuivre ses études de Droit à l’Université de Madrid. N’étant pas tenu d’être présent sur le campus, Vallejo reste à Paris, où il continue à percevoir cet argent pendant deux années. Cette bourse, ainsi que le revenu de ses articles lui permettent de prendre gîte en 1926 à l’hôtel Richelieu ; il fréquente les expositions, les concerts et les cafés ; il rencontre Artaud, Tzara, Desnos, Marcel Aymé, Picasso, Cocteau…Mais il entre également en relation avec Juan Larrea, qui deviendra son ami. Larrea est un poète d’origine basque, qui mourra en 1980, à 85 ans, en Argentine. Il a participé au mouvement « créationniste », s’est ensuite orienté vers l’ultraïsme, puis vers le surréalisme. Une grande partie de son œuvre est écrite en français ; ayant été diffusée de façon très restreinte, elle est très peu connue. Son credo personnel l’éloigne de toute contrainte, de toute norme artistique, de toute hypocrisie. « Aujourd’hui, en 1926, dit Larrea, l’art est un problème de générosité. […] Intelligence et sensibilité sont ennemies, non dans le temps ni dans l’espace, mais à l’intérieur de chaque être humain, là où elles existent uniquement. Tel est à l’exclusion de tout autre, leur vrai champ de bataille. » (in Gerardo Diego, Poesía española : antología, Madrid, 1934). La production de Vallejo, durant cette période, est sans concession, foncièrement directe ; elle fait le lien entre la période de Trilce, et la poésie dense et généreuse qui suivra, dans les années 30.
Yo no sufro este dolor como César Vallejo. Yo no me duelo ahora coma artista, como hombre ni como simple ser vivo siquiera. Yo no sufro este dolor como católico, como mahometano ni como ateo. Hoy sufro solamente. Si no me llamase César Vallejo, también sufriría este mismo dolor. Si no fuese artista, también lo sufriría. Si no fuese hombre ni ser vivo siquiera, también lo sufriría. Si no fuese católico, ateo ni mahometano, también lo sufriría. Hoy sufro desde más abajo. Hoy sufro solamente. (Voy a hablar de la esperanza)
« Je n’éprouve pas cette douleur en tant que César Vallejo. Je ne souffre pas à présent en tant qu’artiste, en tant qu’homme ni même comme simple être vivant. Je n’éprouve pas cette douleur en tant que catholique, mahométan ou athée. Aujourd’hui je souffre simplement. Si je ne me nommais pas César Vallejo, je sentirais aussi cette douleur. Si je n’étais pas artiste, je l’éprouverais aussi. Si je n’étais ni catholique, ni athée, ni mahométan, je l’éprouverais aussi. Aujourd’hui je souffre de plus bas. Aujourd’hui je souffre simplement. » (« Je vais parler de l’espérance » – L’édition française inclut ces poèmes en prose dans la section « Poèmes de Paris », tandis que l’édition complète américaine de Clayton Eshleman, parue en 2007, les intègrent aux Poèmes Humains.)
En 1927, il reçoit des nouvelles de son affaire péruvienne : le tribunal persiste dans les poursuites à son endroit ; il est confirmé dans sa décision d’avoir fui son pays. Il quitte cependant son emploi à l’agence de presse et refuse le versement de la bourse espagnole. Sa situation financière se dégrade. En 1928, il lit la littérature marxiste et entre au Parti Communiste. En septembre, il fait son premier voyage (il en fera trois) en Russie soviétique, et en compagnie d’autres expatriés, forme les bases du Parti Socialiste Péruvien. Janvier 1929 : il vit avec Georgette Philipart ; il l’a rencontrée à son arrivée à Paris (après quelques autres relations, en particulier avec une belle modiste, Henriette, au pittoresque « langage de cocotte »). Ernesto More, l’ami avec lequel il « partagea ses quignons de pain », a été le témoin de cet amour lumineux entre le poète sud-américain et la francesita venida a menos, « la petite française tombée dans la misère ». L’histoire a duré jusqu’au mariage en 1934 : les difficultés financières, ainsi que la détérioration de la santé de César, mettront leur union à l’épreuve. Yo siempre estoy sola, con Vallejo o sin Vallejo, « Je suis seule, avec ou sans Vallejo. », dira-elle en confidence à More, pour décrire son existence avec cet être torturé. Il ne veut plus écrire de poésie, pour se consacrer à la rédaction d’un ouvrage marxiste théorique. Il laissera à sa mort une somme assez conséquente de matière, plusieurs centaines de pages.
Vallejo est arrêté par la police dans une gare parisienne en décembre : il est sommé de quitter le pays. Il revient à Madrid où, en 1931, il écrit un roman, El tungsteno. La Monarchie tombe et la République est proclamée ; Vallejo rejoint officiellement le Parti Communiste Espagnol, devient l’ami de Garcia Lorca, et après la parution de Rusia en 1931, il acquiert une notoriété relative. Ses productions suivantes ne trouveront toutefois pas d’éditeur. De retour à Paris en janvier 1932, Georgette trouve l’appartement mis à sac par la police. Pendant ce temps, César tentait désespérément d’établir des contacts avec les maisons d’édition madrilènes. Après avoir enfin obtenu un permis de séjour en février 1933, il revient à Paris sans autre bagage que les vêtements qu’il a sur le dos. Ce permis précisaient bien entendu une interdiction de quelque activité politique que ce soit. Les années suivantes, de 33 à 36, sont les plus sombres de son existence. Après leur mariage, l’impécuniosité de César et Georgette prend un tour dramatique. Vallejo trouve enfin un emploi d’enseignant en 1936. La montée du fascisme en Espagne, en juillet, lui inspire un regain de créativité spectaculaire. La lutte anti-fasciste, pour la défense de la cause « loyaliste » (celle du gouvernement républicain légal, que Franco et ses sbires cherchent à renverser), lui donne l’occasion de développer une forme de « poésie populaire », d’où le reportage de guerre n’est pas absent, tout en conservant à son travail cet aspect sinon hermétique (le mot serait controuvé, dans le cas de Vallejo : il révèle une paresse de perception), du moins éloigné des conventions de pensée et des lieux communs d’expression, qu’il a toujours eu.
Départ, à nouveau, pour l’Espagne, en juillet 1937. La guerre civile fait rage. Vallejo prend part au Second Congrès International des Écrivains pour la défense de la Culture, en tant que représentant de son pays d’origine. En Espagne, il a visité le front et vu l’horreur des combats. De retour à Paris, il écrit une tragédie en quinze tableaux, La piedra cansada (« La pierre fatiguée »), et dans le même élan de création, de septembre au début de décembre, vingt-deux des vingt-quatre poèmes de Sermon de la barbarie (intégrés au reste de l’oeuvre, par la suite), ainsi que quinze des poèmes qui constitueront España, aparte de mi este cálize.
Début mars 1938, les années de privation, de fatigue accumulée et de déception après l’expérience espagnole, vont aboutir à l’inéluctable. Vallejo contracte une fièvre persistante, au point de ne pouvoir bientôt quitter le lit. Il reçoit des soins, mais sans effet. On ne sait par quel moyen combattre le mal ; son épouse fait même appel aux astrologues. Le 15 avril au matin, les Fascistes atteignent la Méditerranée, coupant le territoire tenue par les Loyalistes en deux. Coïncidence, Vallejo crie du fond de son lit : « Je vais en Espagne ! Je veux aller en Espagne ! » et il meurt. C’est le Vendredi Saint. Le registre de la clinique porte la mention d’une « infection intestinale sévère ». Son corps est enterré à Montrouge. Dans les années 60, Georgette, qui vivait à Lima, fait transférer ses restes au cimetière de Montparnasse.
Me moriré en Paris con aguacero un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en Paris – y no me corro – tal vez un jueves, como es boy, de otoño.
« Je mourrai à Paris sous la pluie, un jour dont je me souviens déjà. Je mourrai Paris et je ne me dérobe pas peut-être un jeudi d’automne, comme aujourd’hui. »
(Piedra Negra sobre una Piedra Blanca, « Pierre noire sur pierre blanche »)
Les poèmes cités dans cette biographie sont extraits de la nouvelle version proposée par la collection Poésie, chez Flammarion. La traductrice, Nicole Réda-Euvremer, nous donne également une préface éclairante – introduction à l’oeuvre d’un poète assez injustement traité jusqu’à présent chez nous.
Ce travail on ne peut plus honnête nous délivre tout d’abord en effet de la version antérieure, chez le même éditeur, – qui combinait, de façon indécente, divers et laborieux maniérismes (un seul exemple : « nervement » pour rendre le néologisme nervazón, qu’un désormais logique « nervaison » rend aisément), à-peu-près (on n’y comptait plus les vers tronqués, les disparitions de membres de phrases, les lourdeurs voulant passer pour des bonheurs d’expression…), coquilles énormes (un « né » à la place de « nié », entre autres, tout de même…!) et de franches idioties. Un dernier exemple, alliant le snobisme à l’imprécision… Soit les deux premiers vers de Para el alma imposible de mi amada : Amada: no has querido plasmarte jamás / como lo ha pensado mi divino amor... Notre fantaisiste disait donc : « Aimée : jamais voulu tu n’as te concréter/comme l’avait pensé mon amour divin… » Monsieur Jourdain, revenez ! Il est vrai que ce même traducteur, alors, nous avait aussi gratifié d’un parfait massacre de l’Altazor de Vicente Huidobro, heureusement rédimé depuis par la version intitulée Altaigle de Fernand Verhesen aux éditions Unes). Le plaisantin, digne du pontife des lettres friand d’ « imbécillités », d’avant-gardiste à la mie de pain, est depuis devenu romancier à succès. – Impossible de ne pas parler de ce genre de travaux bâclés ou frauduleux, si l’on veut apprécier maintenant le nouveau texte français…
La version de Nicole Réda-Euvremer traduit les deux vers cités ci-dessus simplement, – comme il se doit, devrait-on dire : « Aimée : tu n’as jamais voulu prendre forme/ comme l’a pensé mon amour divin… » (« Pour l’âme impossible de mon aimée »). Tout ridicule possible est ainsi effacé. La pensée est honorée ; la forme est respectée. Le poème suit sa ligne dès le départ, faite de vénération inspirée par la tradition catholique dont Vallejo était tributaire, et de détournement expressif – dans la surprise que peut occasionner la fin de la phrase –, et signifiant – dans un contexte péruvien marqué par cette tradition, et ici renouvelé dans le sens d’une modernité douloureuse, où un certain romantisme désuet s’efface devant une nécessité autrement plus impérieuse : dire la souffrance sans déchoir, exprimer l’amour sans sombrer dans la niaiserie, ni bien sûr cet alexandrinisme pseudo-avant-gardiste que nous venons de croiser.
S’il est certes une œuvre qui demande, mérite, exige considération pour l’esprit autant que pour la lettre, et tact dans le traitement que la traduction doit lui réserver, c’est bien celle de Vallejo. Cette poésie touche directement qui la pratique. Pourvu que le lecteur se tienne dans un état de réceptivité particulier – ou plutôt si ce lecteur veut bien s’ouvrir à une tonalité singulière, car les mots sont employés là avec une précision qui dépasse la simple nécessité de se faire uniquement appréhender par l’intellect raisonnant –, une résonance immédiate se produit : plus que d’être compris, le poème de Vallejo demande à être entendu, et requiert la faculté de suivre les variations intimes de la langue elle-même, chargée là de tant de poids d’être, de patience – constance & souffrance – dans la passion de vivre. L’âpreté sans fard du propos, l’intelligence manifeste (de cette intelligence qui engage l’être entier, quant à son rapport au réel) dont cette oeuvre est imprégnée réclame attention soutenue, ouverture et pénétration sans préjugé, et surtout pas préjugé poétique, afin que ses répercussions sensibles aient chance d’advenir.
Impossible aussi, bien entendu, d’analyser cette poésie comme relevant d’un seul répertoire, qui serait reconnaissable, et rassurant. C’est que Vallejo joue précisément sur plusieurs registres, et se livre à des fréquents glissements de l’un en l’autre, parfois dans le même poème. Les tensions internes qui travaillent la langue génèrent des hoquets, des fragmentations, des silences… Le travail du traducteur sera par conséquent celui d’un artisan vigilant : il s’agit de ne rater jamais le moment où ces distorsions, ces ambiguïtés, ces ambivalences déposent, sans se laisser aller à des jeux d’équivalences gratuits… La parodie, chez Vallejo, côtoie le pathos, une forme aiguë, maladive, de sentimentalisme est rongée par l’ironie sous-jacente, la braise consume d’emblée le mot, ou couve sous le sens.
La phrase se fait constellation – échos, souvenirs, influences : les traditions littéraires se télescopent à vive allure ; l’éducation reçue vient saborder la culture acquise dans les livres, à moins que ce ne soit ce savoir qui pervertit ce que l’enfance a emmagasiné. Incertitudes, sentiment de la faute, désarrois, enthousiasmes aussi, mais comme scellés d’angoisse… La honte devant la souffrance d’autrui vient sanctionner le plaisir qu’on prendrait à satisfaire ses propres désirs.
Dans Les Hérauts noirs, le premier livre (1918), Vallejo affronte ses démons, droit venus de la théologie catholique : sexualité et péché sont, dramatiquement, confondus. Avec Trilce (1922), nostalgie des liens familiaux, des bonheurs effacés par le temps et la nécessité de devenir adulte, de se mesurer au danger qui menace : « Fournil ardent de mes biscuits d’antan/ pur jaune enfantin innombrable, mère… » (Poème XXIII). La religion ne permet plus de prendre en charge l’anxiété de l’être soumis aux aléas de l’existence ; sa rhétorique s’absente, le langage se fait là souverain, dans sa spécificité personnelle ; la solitude du poète induit une expression qui ne trouve plus ses propres ressources qu’en elle-même. Les Poèmes humains ont été publiés après la mort de Vallejo ; de même, les poèmes d’Espagne, écarte de moi ce calice, publié en 1939 par les Républicains, comme l’Espagne au coeur de Neruda : là, ce sont d’autres sentiments, ceux de l’angoisse collective, de la compassion, mais imprégnée d’une attention particulière aux problèmes du monde.
À l’instar de Pablo Neruda comme de Rubén Darío, Vallejo est une figure majeure de la poésie américaine d’expression hispanique. Il partage avec eux une origine curieuse : rien ne prédisposait ces trois hommes à ce destin littéraire. Il est né dans son hameau de montagne d’une lignée singulière, Darío est un enfant illégitime issu d’un village isolé du Nicaragua, et Neruda le fils d’un employé des chemins de fer d’une région perdue du Chili. Venus tous trois de leurs provinces, ils sont allés rejoindre les cités neuves de la modernité et s’intégrer aux centres de la vie culturelle internationale. Vallejo est le seul des trois à n’avoir été reconnu qu’après sa mort, après une vie marquée par la misère et la douleur d’être, et la conscience du malheur universel. Darío a été le père du modernismo dans le monde hispanophone américain : Borges comme Paz, pour prendre deux exemples tout aussi célèbres, en sont les héritiers : comme lui, ils tiennent que les paramètres de leur production personnelle n’ont plus rien à devoir à la littérature européenne ; d’ailleurs la littérature espagnole elle-même subit au début du XXe siècle le même genre de transformations avec Jiménez ou Lorca, entre autres… Neruda, lui, qui deviendra le récipiendaire et du prix Lénine et du prix Nobel, a défini la langue qu’il utilise dans de très larges limites où le lyrisme d’une ode sait naître de la considération d’un objet quotidien comme une ample et fluente versification peut se mettre à chanter avec pathos. La différence entre Neruda et Vallejo est sensible dans le traitement réservé à cette affaire de la Guerre Civile. Dans Espagne au coeur, Neruda exprime souffrance et indignation, mais aussi des certitudes, une foi assurée de ses fins :
« Mais de chaque brèche en Espagne l’Espagne se relève mais de chaque enfant mort se relève un fusil avec des yeux, mais de chaque crime naissent des balles qui trouveront un jour leur cible dans vos cœurs. »
La réponse de Vallejo est beaucoup plus angoissée et incertaine, malgré l’engagement réel et fort du poète dans le combat. Du premier au dernier des poèmes, d’un bout à l’autre d’Espagne, écarte de moi de calice, ce tremblement parcourt la parole de Vallejo :
« Volontaire d’Espagne, milicien aux os dignes de foi, quand marche ton coeur pour mourir, quand il marche pour tuer avec son agonie mondiale, vraiment je ne sais que faire, où me mettre… »
(Hymne aux volontaires de la République)
[…] « … si notre mère Espagne tombe – enfin, c’est façon de parler – Partez, enfants du monde ; partez la chercher… ! » (Espagne, écarte de moi ce calice) Mais si l’on veut apprécier l’oeuvre de Vallejo dans son originalité et son authenticité – celles d’un homme qui assimile et recrée, qui va puiser à toutes les sources pour tracer le cours exact et vigoureux de son propre fleuve, il faut lire ses poèmes dans leur ordre, et voir se moduler une voix qui porte avec les temps, avec les épreuves, avec une constante application à coïncider avec soi.
Dans son premier âge, Vallejo a tout lu, aussi bien des classiques espagnols (Quevedo, Lope…) que des Péruviens antérieurs, auxquels une part de son sentimentalisme, mais très resserré, dirions-nous, comme épuré par le traitement de la langue, est redevable… Un critique, Antonio Armisén, a montré que la fréquentation des poètes de l’Âge d’Or est aussi sensible dans les Hérauts noirs que dans les Poèmes Humains. Le sonnet « Intensité et altitude » (page 314), qui commence par « Je veux écrire mais il me vient de l’écume… » n’est pas uniquement une variation sur un sonnet de Lope de Vega qui commence par « Je veux écrire, mais mes larmes m’en empêchent », mais est, bien plus, une « déconstruction de la langue poétique et religieuse », dit Armisén, incluant même Jean de la Croix. Le titre des Hérauts noirs est un hommage à Darío, qui avait intitulé un de ses poèmes précisément « Los heraldos » ; mais l’autre figure dont Vallejo est tributaire est celle de Baudelaire, pour la noirceur. L’idiome symboliste de Darío et du premier Juan Ramón Jiménez donne lieu à une esthétique dont l’intensité est palpable dès la première ligne :
Hay golpes en la vida, tan fuertes… Yo no sé !
« Il est des coups dans la vie, si rudes… Je ne sais ! »
Ce n’est pas tant dans les mots eux-mêmes que le pathos est sensible, mais précisément dans le silence de l’ellipse. Pathos : ce mot étant ici employé pour désigner l’exact contraire de son acception courante de déclamation ostentatoire, et revenir à son étymon d’épreuve, de peine qui étrangle, et cependant demande expression, comme de sombre joie, qui veut traces laisser. Voix brisée, souffle court, impossibilité de terminer la phrase, impossibilité de s’en remettre même à un dieu compatissant : la souffrance humaine est là, dans le présent éternel de la misère. Les « coups » dont parle Vallejo furent la part constante de son destin.
Durant une de ses hospitalisations, Vallejo écrit à un ami, Pablo Avril de Vivero :
« Dans la vie, Pablo, il existe une obscure noirceur, au plus près de toute consolation. Il est des heures qui sont plus sinistres et atroces que notre propre tombe…Dans ma convalescence il m’arrive de pleurer souvent sans la moindre raison. Une propension enfantine aux larmes m’a saturé d’une immense pitié pour tout. Je pense souvent à chez moi, à ms parents, et à l’affection perdue. Un jour je finirai par mourir dans le cours même de cette vie à risques qui a été mon lot, et alors, comme aujourd’hui, je me retrouverai tout seul, orphelin sans famille ni même amour… dans quelques jours, je vais quitter l’hôpital, c’est ce que dit le docteur. Dans la rue la vie m’attend pour me porter ses coups, à volonté. »
Vallejo transforme sa propre douleur en pitié pour l’ensemble de l’humanité. Ces « coups » sont ceux du « destin » ; ils sont aussi à mettre en parallèle avec la « haine de Dieu ». Ce n’est pas l’âme de l’homme qui tombe dans le cadre de la foi chrétienne, mais la Chrétienté elle-même qui vient se perdre dans l’humain : les souffrances, les « coups » sont « les chutes profondes des Christs de l’âme, / d’une foi adorable que le Destin blasphème». L’humain n’attend rien du Sauveur : c’est le Sauveur qui « chute » chaque fois que l’âme est abattue par les « coups » de la vie.
Si l’on voulait chercher à Vallejo un équivalent dans la littérature occidentale, il faudrait se tourner vers Beckett, mais surtout un personnage de Beckett, celui de l’esclave de Pozzo, Lucky, dans En attendant Godot, qui parle, lui, de ce Dieu qui « des hauteurs de sa divine apathie … nous aime tendrement avec des exceptions pour des raisons inconnues » ; Lucky est à la fois la victime de la brutalité du monde et un observateur compatissant des faiblesses humaines. Vallejo partage avec ce personnage la préoccupation des fonctions vitales du corps, des traverses que l’homme doit subir, de la crainte des manquements de ce Dieu distant, indifférent aux tourments :
Con él anochecemos. Orfandad…
« Ensemble nous sombrons dans la nuit, orpheline Solitude… »
(« Dieu », in Les Hérauts noirs)
La traductrice, là, réussit à rendre avec simplicité, sans délayage excessif, une formulation très condensée, que l’impossible mot à mot trahirait, en faisant de ce vers quelque chose comme un horrible « Avec lui nous nous en-nuitons. Orphelinité… » La version antécédente avait cette banalité, accompagnée d’un maniérisme : « Ensemble nous nous obscurcissons. Orphelinage… ». On voit que la tâche n’est pas facile, en tout cas… La traductrice reprendra d’ailleurs cette formulation d’un poème d’une série antécédente : souci de cohérence.
Dieu dérisoire, aléatoire, imbécile vraiment, lui :
Dios mío, si tú hubieras sido hombre, hoy supieras ser Dios ; pero tú, que estuviste siempre bien, no sientes nada de tu creación. Y el hombre sí te sufre : el Dios es él !
« Mon Dieu, si tu avais été un homme, aujourd’hui tu saurais être Dieu ; mais toi, qui as toujours été bien, tu ne sens rien de ta création. En fait l’homme te souffre : le Dieu c’est lui ! »
(« Les dés éternels », in Les Hérauts noirs)
Le titre premier de Trilce devait être Cráneos de bronce, « Crânes de bronze ». Cette image de crânes lourds et colorés, semblables à des pierres marquées d’ecchymoses, on le retrouve dans le discours de Lucky, lorsqu’il est assailli par son maître Pozzo ainsi que par Vladimir et Estragon, et c’est le thème des « Pierres » :
Las piedras no ofenden ; nada codician. Tan sólo piden amor a todos, y piden amor aun a la Nada.
« Les pierres n’outragent pas, ne convoitent rien. Elles ne demandent que de l’amour pour tous, et demandent même de l’amour pour le Néant. »
De cette situation, du souffre-douleur tiré pour une corde et battu sans raison, on trouvera encore l’écho dans ce chef d’oeuvre, déjà cité, Piedra negra sobre une piedra blanca, en quelque sorte emblématique du destin de Vallejo :
César Vallejo a muerto, le pegaban todos sin que él les haga nada ; le daban dura con un palo y duro
también con una soga ; son testigos los días jueves y los huesos húmeros, la soledad, la lluvia, los caminos…
« César Vallejo est mort, tous le frappaient sans qu’il leur ait rien fait ; on le tapait dur avec un bâton et dur aussi avec une corde ; en sont témoins tous les jeudis et les os humérus, la solitude, la pluie, les chemins… » La comparaison avec Godot n’est pas fortuite, évidemment… Quand il composait sa pièce, Beckett travaillait pour l’UNESCO et sa tâche était de fournir une version de poèmes latino-américains en anglais (il devait en résulter, en 1958, une anthologie de la seule poésie mexicaine, assemblée par Octavio Paz). C’est sans aucun doute avec Trilce que Vallejo forge définitivement sa voix. Plus aucune discussion avec le dieu déserteur d’humanité. La tragédie est au coeur du réel. Vallejo rate une tentative de suicide ; son soutien littéraire Abraham Valdelomar meurt ; il connaît la prison, pour cette absurde affaire de participation supposée aux troubles de Trujillo. Ruptures de constructions, phrases inachevées, consonnes majuscules répétées à l’intérieur des mots, espaces variables entre les mots, mots écrits en verticale…, et surtout nombre de néologismes, ou d’usage en porte à faux : noms devenant verbes, et verbes s’adjectivant. (On a pu, de l’autre côté de l’Atlantique, tenir cette démarche pour un avant-goût des pratiques de la Language Poetry… Rien de moins certain. Vallejo ne joue pas l’air d’un esthète purement langagier, car sa façon de faire répond à d’évidentes nécessités intérieures et non à la volonté de s’illustrer dans un genre artificiellement fabriqué ; et l’expérience humaine dont il témoigne n’est certes pas non plus celle d’universitaires linguistiquement titillés d’avant-gardisme !)
C’est, toutefois, ce qui fit réagir en son temps un Clemente Palma, déjà cité, qui ne vit dans le recueil qu’affront au bon goût ; et Luis Alberto Sánchez, une chose « incompréhensible ». Un seul critique local, C. Alberto Espinosa Bravo (en 1925, dans la revue Mundial) fit preuve d’ouverture d’esprit : « Trilce est incompréhensible, parce qu’étrange, sans équivalent, et puissant. Comprendre ce livre réclame une attitude critique déliée et un capital psychologique exceptionnel. » La caractéristique principale du recueil, déconcertante pour un esprit calé sur des principes de clarté immédiate, est en effet un glissement constant du réalisme parfois très cru au sentiment, puis à l’expérimentation formelle ou au symbolisme : on passe par exemple de l’évocation du souvenir de noms de l’enfance née des soucis de l’âge adulte et recherchée comme un antidote à la situation vécue dans le présent (poème III) à l'angoisse provoquée par la considération de nombres chargés d’une puissance symbolique inexplicable. C’est que Vallejo dialogue encore avec ses maîtres, et la recherche de l’efficacité tient chez lui l’écho intérieur : la référence la plus apparemment étrange n’est souvent que le développement d’une réflexion où la référence entre en état de germination. Le poème XXXVI offre une réponse explicite à l’ars poetica de Darío, un poème intitulé chez celui-ci Yo persigo une forma, « Je suis en quête d’une forme ». Ruben Darío exprimait, classiquement en quelque sorte, la recherche de l’harmonie par l’image de l’« impossible étreinte de la vénus de Milo » ; Vallejo reprend l’image et la dissèque :
¿Por ahí estás, Venus de Milo? Tú manqueas apenas pululando entrañada en los brazos plenarios de la existencia, de esta existencia que todaviíza perenne imperfección.
« Es-tu là, Vénus de Milo ? Menchote tu es à peine, pullulant Enfouie dans les ras pléniers de l’existence, De cette existence qui encore Pérenne imperfection. » La proposition qui se trouve au centre du poème fait exactement répond aux préoccupations du maître : Rehusad, y vosotros, a posar las plantas en la seguridad dupla de la Armonía. Rehusad la simetría a buen seguro.
« Refusez, et vous aussi, de poser les pieds sur la sécurité double de l’Harmonie. Refusez la symétrie sans aucun doute. »
Quevedo voyait le passage du temps comme soumis à des ralentissements ou des accélérations ; Vallejo en reprend le thème, dans le poème LXIV, pour ré-agencer un tourbillon de souvenirs dans un ordre qui ne tient plus aucun compte de la logique :
[…]Oh voces y ciudades, que pasan cabalgando en un dedo tendido que señala a calva Unidad. Mientras pasan, de mucho en mucho, gañanes de gran costado sabio, detrás de las tres tardas dimensiones.
Hoy Mañana Ayer
(No, hombre!)
« Oh voix et villes qui passent en chevauchant un doigt tendu qui désigne une chauve Unité. Tandis que passent, de loin en loin, des rustres au grand côté sage, derrière les trois lentes dimensions.
Aujourd’hui Demain Hier
(Mais non, voyons !) »
Dans son poème intitulé El hermano ausente en la cena de Pascua, « Le frère absent de la cène de Pâques », Valdemonar dit l’angoisse de la mère au repas familial après la mort du fils :
« Il y a là une place vide vers laquelle ma mère porte son regard de miel et le nom de l’absent est murmuré mais il ne viendra pas aujourd’hui à la table pascale. »
Vallejo, dans le poème XXVIII, reprend le thème là aussi mais pour en dégager une variation personnelle. C’est une mère qui est absente, et le personnage qui parle est en désir d’un impossible repas partagé ; puis, invité à la table d’un ami, où la mère est également absente, il y a cependant une sorte de communion qui se produit ; mais le personnage qui s’exprime, et qui est Vallejo, on le sent bien, se retrouve en plus grande détresse encore, en compagnie de gens qui pourtant partagent le deuil : les « douceurs » se transforment en « fiel », lequel répond au « miel » du poème de Valdemonar, et le simple « café » en « huile funèbre ».
Cesar Vallejo par Auxeméry/article paru dans Poezibao, juin 2009
SUR LE CHEMIN DES EVIDENCES – PAGE 1 : http://mickael-montest.e-monsite.com/pages/sciences-sociales/page-1.html
PAS PENSER, PAS PANSER,
Sale bête éructant les vieux mots infâmes,
Ceux qui n’ont de noms que les plus fourvoyés(es),
Petit homme sectaire branlant sous sa propre bave,
Immatures prologues vantant le sectarisme de masse,
Est-ce là vocation sortie d’esprits malingres… ?
Pas penser, pas panser, arbitraires pervers.
Symboles mornes torchant les ignominies veules,
Ceux qui n’ont d’existence que des plus ravis,
Grisées tribunes dépravées sous la lune brune,
Serviles postures cernées des venins d’échafauds,
Sont-ce là poncifs servis à desseins comptables… ?
Pas penser, pas panser, vilénies clandestines.
Média-sapiens communiant sophisme de titres,
Inaptes paralogismes, ineptes transmissions,
Celles perdues dans des gloses de substitution,
Ceux viciés aux bagagistes, voyages en leasing,
Est-ce ici parfum d’agences en monde perdu… ?
Pas penser, pas panser, horizons sans-soucis.
Grand homme sans spécialité riche comme Crésus,
Ceux qui n’ont d’esthète que panégyriques soldées,
Estrades de bourrades sans veilleurs de portiques,
Avis stérilisés comme noces admirables,
Sont-ce ici litanies sans paille dans l’acier… ?
Pas panser, pas penser la volonté d’Hydres,
Vois-là, voici la grande prière est lâchée ;
Espérance gourde comme costumiers sans mémoires,
Oubliés déchets, débris, marches douteuses,
Salonardes sans lanternes comme poussepousses sans but,
Sont-ce, ici et là, rustines en blouses blanches-noires ?
Pas penser, pas penser, aux pantins gourous-girouettes,
Com-nommés consommés comme avidité… ;
L’inutilité aux atours des temples amas-zones,
Celle imposée sous toile de tissus percés,
Etals virtuels soumissionnés aux labeurs pauvres,
Est-ce là territorialisme sans compromis(es)… ???
Pas panser, pas penser, aux vendeurs de chimères…
TEMPS D’OMBRES ; TANT DE SILENCES
Ils nous annoncèrent les grands retours apocalyptiques,
L’ouverture de la terre, des cieux de feu, éclairs de l’enfer,
Le rugissement lugubre des vents, de la mer insoumise,
Sortilèges organisés par les dieux et hôtesses du temps…
Justifiant des horizons rouges sang sur collines noires cendres.
Nous vous avons écoutés, prophètes en discours de paille.
Elles prêtèrent parfois l’oreille en semailles, fontaines de jouvence,
Cœurs en bouche, bouches en cœur, vestiges d’amourettes égarées,
Petites filles, elle ne connaissait que les berges sans histoires,
Celles éloignées des lois en ostracisme sans liens ni benné-risques…
Sinus des contours absorbés par le virus des chants médiatiques.
Nous nous étions tus dans les allées encadrées de douleurs.
Leurs enfantillages étaient restés mimes de frêles créatures,
Gibiers lancés sur les routes de l’errance ; sans étoiles,
Croyant à l’archi-trappe d’horizons vernis aux idéiques,
Tracés d’un radeau sans capitaine, ni pirates de vigilances…
Volonté à donner des leçons, tant aux riens qu’aux rumeurs.
Ils étaient d’excellents professeurs ; farcis du joug maître.
Déclinaisons aux couleurs désuètes, grisées, sans ardoises,
Clés opiniâtres versées aux portes entrouvertes, écueils choyés,
Nous descendîmes à l’extrémité des eaux et de la terre.
Sur une grande table de pierre fut posés les symboles d’un dédale…
Les enfants surent lire son histoire sur des tablettes d’émail bleu.
Nous nous pausâmes aux abords du lieu ; dont on ne sort, jamais.
Michel Asti
VOYELLES
A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu : voyelles,
Je dirai quelque jour vos naissances latentes :
A, noir corset velu des mouches éclatantes
Qui bombinent autour des puanteurs cruelles,
Golfes d'ombre ; E, candeurs des vapeurs et des tentes,
Lances des glaciers fiers, rois blancs, frissons d'ombelles
I, pourpres, sang craché, rire des lèvres belles ;
Dans la colère ou les ivresses pénitentes
U, cycles, vibrements divins des mers virides
Paix des pâtis semés d'animaux, paix des rides
Que l'alchimie imprime aux grands fronts studieux,
O, suprême Clairon plein des strideurs étranges,
Silences traversés des Mondes et des Anges ;
- O l'Oméga, rayon violet de Ses Yeux !
Arthur Rimbaud
« Tenter, braver, persister, persévérer, être fidèle à soi-même, prendre corps-à-corps le destin, étonner la catastrophe par le peu de peur qu’elle nous fait, tantôt affronter la puissance injuste, tantôt insulter, la victoire ivre, tenir bon, tenir tête, voilà l’exemple dont les peuples ont besoin, et la lumière qui les électrise. »
Victor Hugo
Date de dernière mise à jour : 03/03/2020

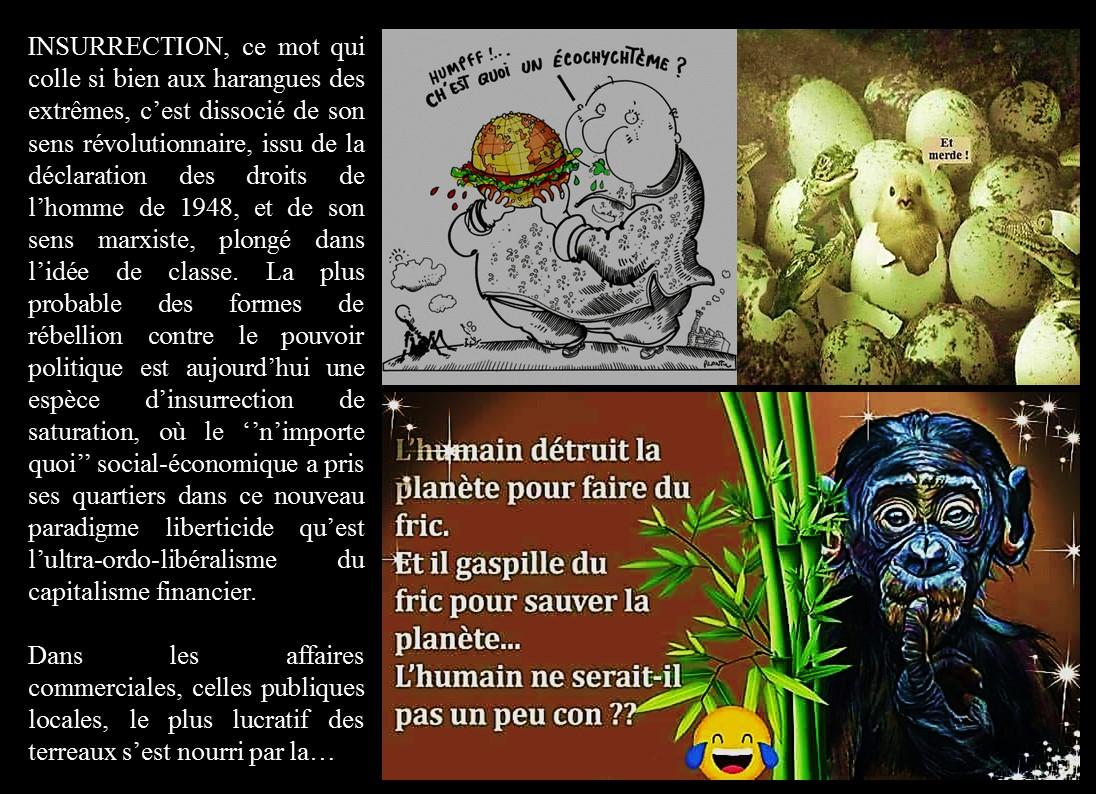




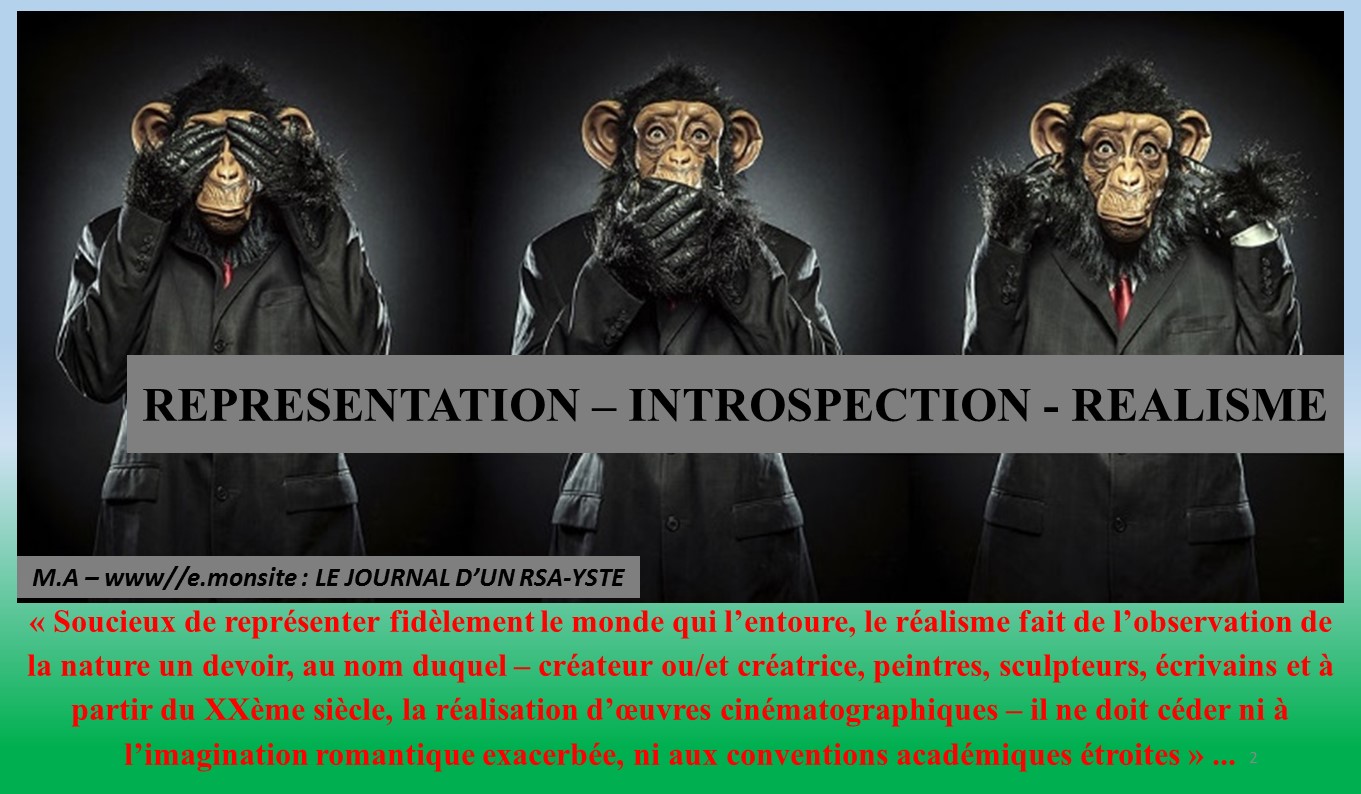








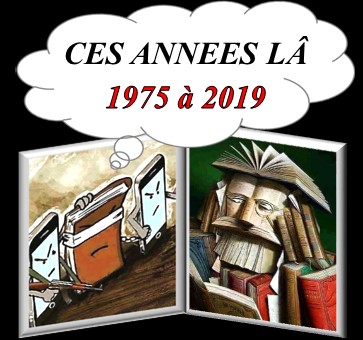





Ajouter un commentaire