Fouquet par Jean-Christian Petitfils
Fouquet par Jean-Christian Petitfils.
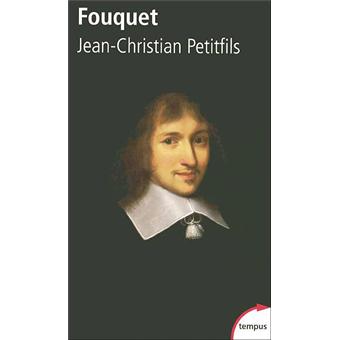
CRISES FINANCIERES, IMPÔTS ET CAPITALISME FISCAL EN FRANCE, AU XVIIème SIECLE
Les ‘’choses’’ et ‘’affaires’’ de l’état, ont-elles réellement changé, sur le fond politique des covalences et convergences, depuis presque quatre siècles… ?
Hors avancées technologiques, numériques, démographiques, sanitaires, médicales et sociologiques… ???
Petit retour en arrière… Notamment la crise du XVIIème en France…
Les disparitions de Richelieu et de Louis XIII avaient avivé la crise politico-financière, et par la même endigué instabilité et conflits sociaux. Le nouveau pouvoir avait fait naître des espoirs très vite déçus. L’amertume n’en était que plus profonde.
Depuis 1635, date du début de la guerre contre la maison d’Autriche, la France avait connu une des mutations les plus importantes de son histoire financière. Si l’on veut avoir une idée de l’augmentation démesurée des dépenses et de l’effort demandé durant ces années terribles, il suffit de considérer quelques chiffres : le budget de l’état, qui était en temps ordinaire de l’ordre de 40 à 45 millions de livres ‘’tournois’’ (monnaie de l’époque), bondit à 120 millions en 1634, l’année des premiers efforts militaires, puis à 208 millions en 1635, l’année de la guerre. Il descendit à 88 millions en 1637, s’établit à 89 millions en 1642. Avec le ministre Mazarin, cette croissance reprit : 124 millions en 1643, 141 en 1644, 136 en 1645. Il était de 142 millions en 1651 et de 109 en 1653 (La paix de Westphalie signée avec l’empire en 1648, n’avait pas mis fin à la guerre espagnole).
Le système des impôts sous l’Ancien Régime était archaïque, improductif, injuste, hérissé d’exemptions scandaleuses et de particularités choquantes qui avaient le plus souvent perdu leur raison d’être. Mais la monarchie aux abois n’était pas capable de le réformer.
De quoi d’ailleurs était-elle capable… ???
Le petit monde trouble de la finance royale et des manieurs d’argent – quelques milliers de personnes en tout, en comptant leurs commis et associés – est aujourd’hui mieux connu par les travaux de quelques historiens anglo-saxons et français, qui ont démontré avec intelligence et clarté les mécanismes déjà forts complexes du système financier de cette époque.
Bien des idées reçues doivent être révisées.
Ces gens de la finance – Bonneau, Catelan, Feydeau, Gruyn, Monnerot, Tabouret… – n’étaient nullement des hommes sortis de la lie du peuple, des laquais enrichis qui auraient réussi à s’agréger au monde des puissants comme l’imagerie populaire les a souvent représentés. Ils étaient issus des milieux de la ‘’robe’’ (ceux de la chaire, juges, avocats, notables…), et de l’aristocratie… Leurs familles avaient travaillé dans le maniement des ‘’espèces du roi’’ depuis une ou deux générations. Ils se manifestaient rarement au grand jour, laissant la première place à des gens de paille – bourgeois de Paris, voire simples domestiques – qui étaient des adjudicataires du bail ou du traité. De discrets actes notariés rétablissaient la ‘’vérité’’. A l’arrière-plan se dissimulaient des bailleurs de fonds encore plus puissants : la haute aristocratie d’épée, les princes, les ducs et pairs, l’élite de la noblesse de robe, les grands dignitaires ecclésiastiques, les abbés commendataires, qui bénéficiaient des revenus les plus élevés. La famille royale elle-même participait au jeu : Le Duc d’Orléans, sa fille la Grande Mademoiselle, le prince et la princesse de Condé. Tous ces gens, à la recherche de profits sans risque, participaient aux lucratives << affaires du roi >> – revenus domaniaux, aides, sous-participations dans les fermes et traités – grâce à des compagnies discrètes, à des conventions de croupiers ou à des prêts simples d’argent. Les cardinaux-ministres, Richelieu, puis Mazarin, investissaient eux-aussi sans vergogne dans ce capitalisme fiscal, prêtant à bon taux l’argent qu’ils avaient capté, faisant main basse sur les grands offices, les revenus du domaine royal, les bénéfices ecclésiastiques, ou touchant des pots de vins lors de l’affermage des impôts…
Ainsi malgré ses ors et sa pompe, la monarchie française était-elle l’otage des puissants, des grandes familles et des multiples groupes sur lesquels elle comptait s’appuyer… ??? Même si par nature elle se situait au-dessus des corps sociaux, les transcendait par son caractère divin, la grève des bailleurs de fonds pouvait lui être fatale. Faute d’une administration fiscale efficace, le pouvoir royal avait perdu la maîtrise de ses finances.
Comment s’étonner que, dans de telles conditions, la misère est rapidement gagnée les campagnes. La pression fiscale imposée par un pouvoir considéré jusque-là lointain et peu enclin à attentions et considérations, hors de la royauté, sa cour, l’église et les gens de robes, avait en partie détruit le fragile équilibre des communautés locales, incitant les habitants à faire bloc pour défendre leurs intérêts régionaux menacés. Les révoltes populaires, qu’on appelait dans le langage du temps des ‘’émotions’’, furent nombreuses.
Apparues dès la fin du XVIème siècle, parallèlement à la croissance de l’Etat royal, elles connurent alors de terrifiantes flambées. : Explosion des ‘’Croquants’’ de Guyenne, du Périgord, du Limousin (1636-1642), insurrection des ‘’Nus-Pieds’’ de Normandie (1639-1642), implacablement réprimée par le chancelier Séguier, jacqueries paysannes dans le Maine et l’Anjou (1639), en Auvergne (1640), et à nouveau dans le Poitou (1641).
La mort de Richelieu et l’avènement de Louis XIV firent espérer un retour au calme social, et par voie de conséquence, la décrue de la ponction fiscale. Espoir vite déçu ! Une série de mauvaises récoltes aggrava même, en certains endroits, la situation. Les troubles reprirent en Normandie, en Anjou, dans le Poitou, la Guyenne, le Languedoc, le Rouergue, la Provence… Etc…
Pour une sémantique des textes. Questions d’épistémologie.
Les sciences sociales sont à un tournant. Au plan épistémologique, le sociologisme issu de certaines formes périmées du marxisme, puis du capitalisme ‘’débridé’’, du communisme d’antan et de l’ordo-libéralisme subjugué par principe de subsidiarité, (une utopie hors formes de népotisme), a perdu les moyens théoriques de leurs servir de langage commun ; elles sont confrontées à des tentatives de réductions provenant des neurosciences et de sciences cognitives. Enfin la ‘’techno-logo-médiatisation’’ croissante de la recherche scientifique conduit à ne plus vraiment subventionner que des programmes susceptibles d’aboutir en principal à des brevets rentables et commercialisables ‘’rapidement’’ ; quitte pour arriver au but proche d’un corporatisme absolutiste, à faire fi des notions de responsabilités dans le système à réseaux ‘’humains’’… Quant à l’objet des sciences sociales, on ne fait qu’accumuler des connaissances sans précédent sur la diversité des langues et des sociétés humaines, avec un effort sans précédent lui aussi, en tant qu’inventaire et conservation du patrimoine culturel à l’échelon mondial, alors que son véritable degré appelle à présent une réflexion théorique afin de penser la diversité de ce patrimoine, dans le temps comme dans l’espace. Nous sommes confrontés au défi de mettre en valeur la diversité culturelle d’aujourd’hui, pour éviter qu’elle ne se réduise à la portion congrue de sa propre incompréhension aseptisée ; voire irrationnelle ou psychotique. Cela n’exige pas d’opposer un relativisme frileux à un universalisme dogmatique ; mais loin des réductions biologiques anthropologiques, ethnologiques ou sociologiques qui ont tentées depuis l’avènement de l’ère industriel, après la Renaissance et le temps des Lumières, d’en déterminer uniquement les lois et règles sur les états successifs des fonctionnements des biosystèmes et écosystèmes, en faisant trop souvent abstraction ou déni des liens communautaires et culturels des échangistes en, et entre ces différents systèmes à réseaux ‘’vivants’’… Cela conduit à affirmer l’autonomie concise et la spécificité sociologique de la sphère culturelle, et ainsi à poursuivre dans la direction tracée par l’entreprise philosophique des formes symboliques, permettant d’en définir les potentiels contours d’une sémiologie des cultures, fédérant en premier lieu les échanges par la linguistique, les mathématiques, la philosophie, l’histoire, l’anthropologie, la métaphysique (sachant que méta signifie : plus, après, entre, plus loin… Et pas autres choses spéculatives non prouvables par les connaissances épistémologiques) et l’étude de tous ces langages en tant que sigles, symboles, axiomes, lemmes, mots et expressions multiformes, qu’ils, elles soient émis(es), sous formes sonores ou écrites…
Dans l’espace touchant et sensiblement touchable.
Par conséquent, cette question technique pose la question d’un projet refondateur pour les sciences sociales, depuis naguère, et encore aujourd’hui teintées par diverses idéologies et néologismes ‘’troubles’’ au rapport épistémologique de l’éthique ontologique… ; et culturelle assujetties à la déontologie économique et commerciale. (Vastes sujets)…
L’étude des objets culturels complexes apporte en ce sens de multiples enseignements. Aussi, François Rastier (Directeur de recherche au CNRS) aborde dans ses analyses et par sa compétence, quelques questions et réflexions sur la ‘’sémantique du texte’’. La linguistique en reste bien souvent à la phrase et la morphosyntaxe, et constitue de l’avis général son domaine de prédilection. Elle doit encore beaucoup à l’héritage séculaire de la grammaire – la linguistique historique et comparée fondait ses fonctionnalités sur l’analyse morphosyntaxique… Le positivisme contemporain a renforcé cette prédilection. Où le vecteur le plus disqualifiant en est assurément la liberté de croire que l’attachement séculaire ne saurait être en aucune façon facteur déstabilisant par le manque d’attentions et le déni de justes curiosités envers ce, celles et ceux présents en ce monde naturel, assujetti à phénomènes holistiques incompréhensibles… Et en constante évolution…
Michel Asti
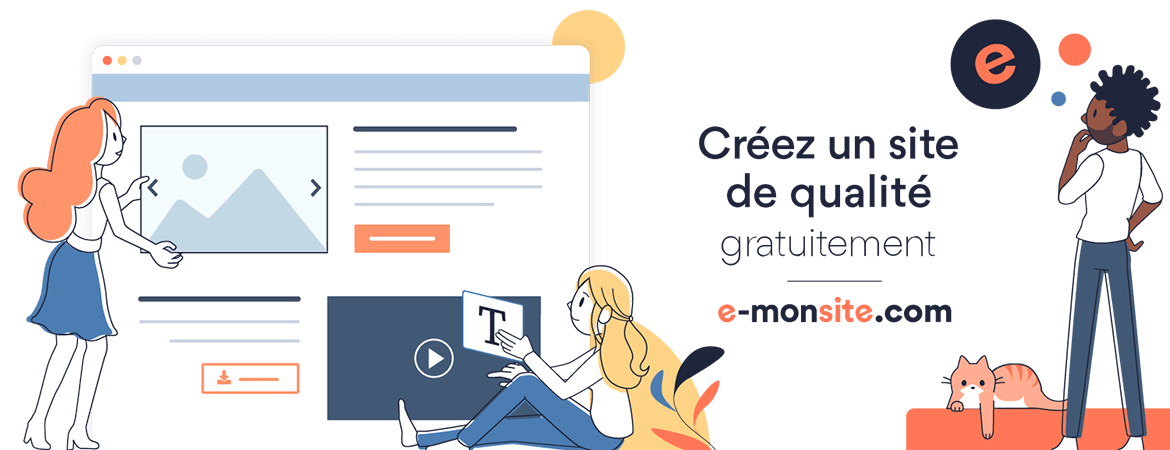

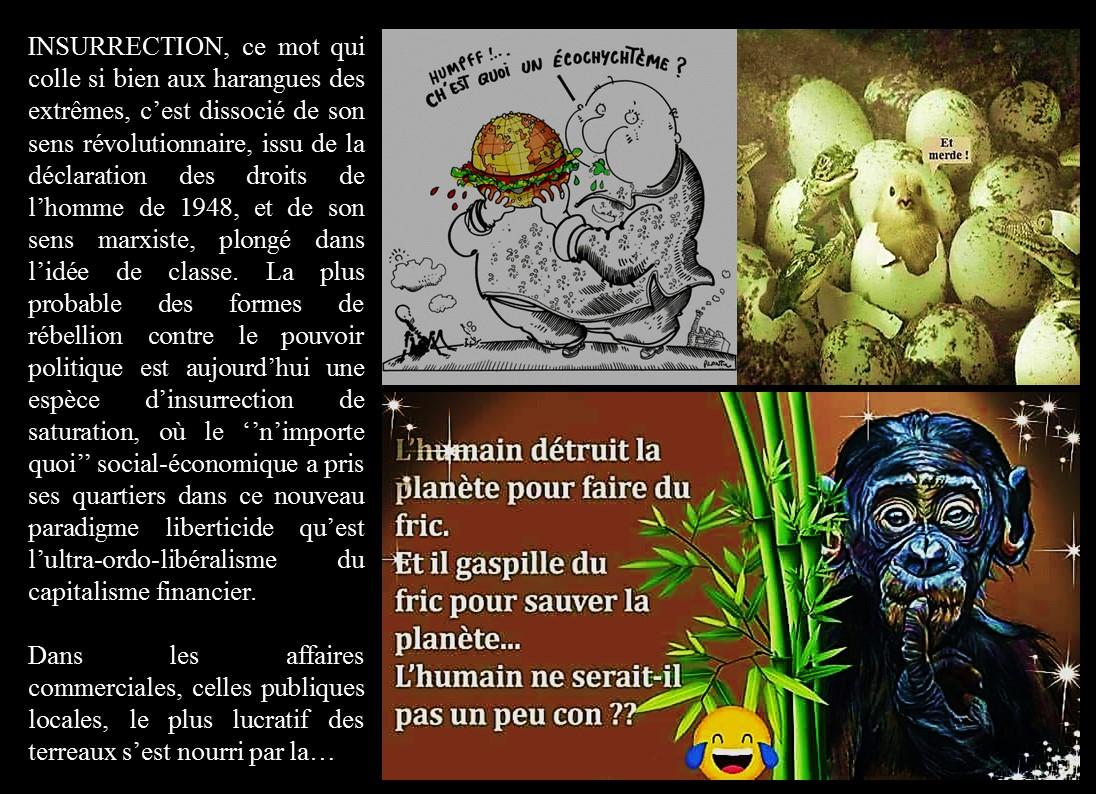




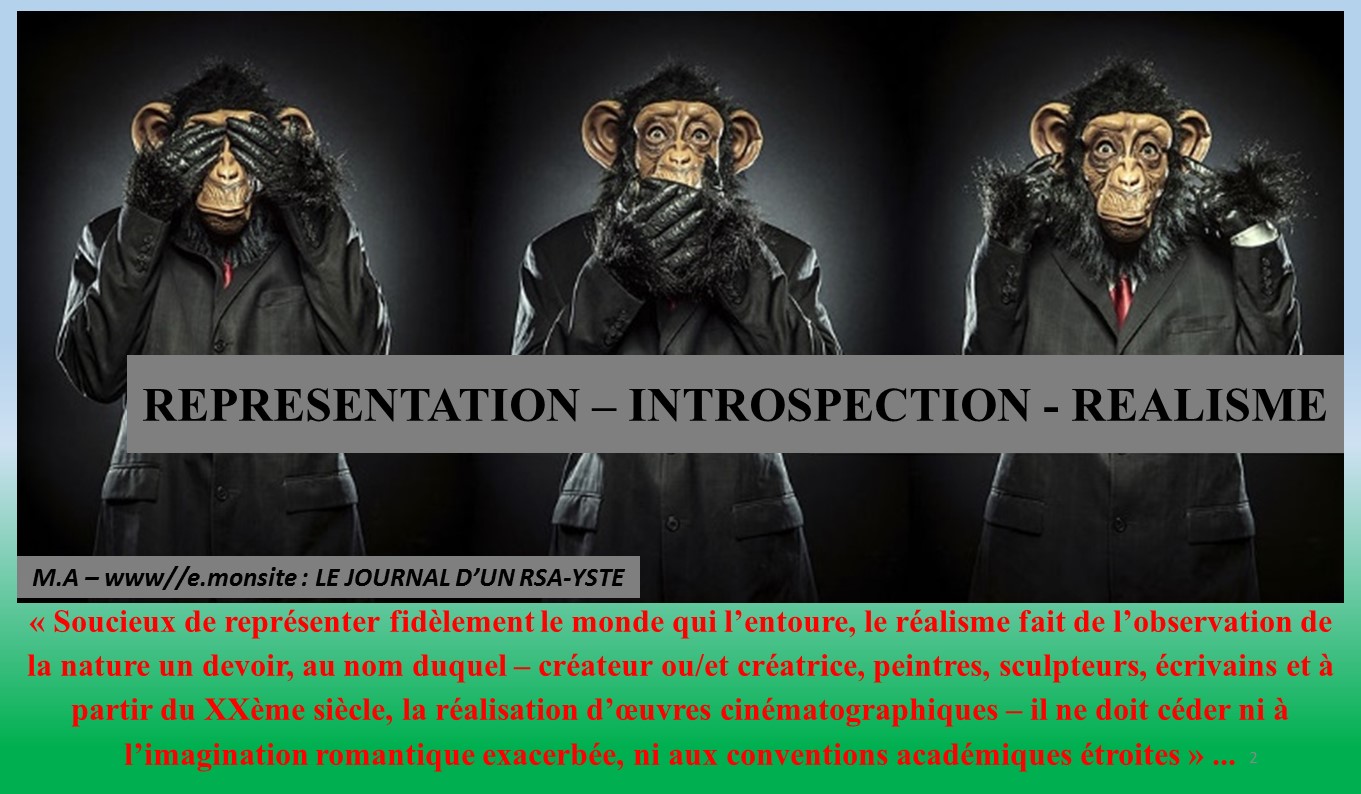






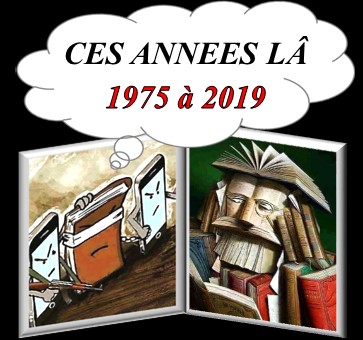





Ajouter un commentaire